 |
| "Madame de Privat et ses deux filles" - Antoine RASPAIL 1791 |
Une femme, jeune et élégante, est assise dans un fauteuil Louis XV.
Elle tient un bébé endormi dans ses bras et, à son côté, une petite fille tient un petit chien sur ses genoux. Le cadrage est serré autour de cette scène. Le mur du fond, proche et sombre finit de fermer l’espace pictural. Ce cadrage induit de la proximité et donne une dimension intime à la scène. Nous sommes face à un portrait classique et de bonne facture. Nous datons sans trop de difficultés cette peinture comme étant du XVIIIème siècle et nous identifions facilement le sujet comme étant celui d’une femme riche et de ses enfants. Tout est là. Rien de plus rien de moins. Les personnages sont statiques et silencieux. Ils posent. Le peintre ne cherche pas à cacher une rigueur induite par l’immobilité des modèles, il ne cherche pas non plus à faire passer un message métaphysique ou à chambouler les codes de la peinture ou de l’Histoire de l’Art.
Je vous présente donc Madame de Privat et ses deux filles. On ne se sait pas grand-chose de cette femme, si ce n’est qu’elle vivait en Arles durant la seconde moitié du XVIIIème siècle, son époux était gouverneur du roi à Beaucaire. Ayant un certain niveau de vie elle a pu se permettre de demander à être portraiturée. Elle fit appel à un artiste local, spécialisé dans le portrait : Antoine Raspail. Ce portrait date de 1791, et je ne vous apprends rien en vous disant qu’à cette époque les femmes n’ont pas beaucoup de liberté ni de réelles importances dans la société.
Mais Antoine Raspail semble être un de ces hommes à porter un regard plus juste sur les femmes. Il a deux soeurs qui ont su prendre de l’importance, la première, Catherine, en ayant une longue liaison avec un homme noble, la seconde, Thérèse, en étant à la tête d’un atelier de couture où elle emploie plusieurs femmes. Fier de ses soeurs, il les peint souvent en les montrant dans leurs vies quotidiennes. Il réalise aussi de nombreux portraits de femmes, le plus souvent des anonymes issues de la classe intermédiaire qui se parent pour l’occasion de leurs plus beaux costumes et bijoux.
Comment c’est passé la première rencontre entre l’artiste et Madame de Privat ? Personne ne le sait. Il devait s’agir d’une commande personnelle, d’un portrait destiné à la sphère privée. En cela ils ont dû convenir d’un prix, d’un format et d’un délai. Ils ont dû aussi parler de ce qu’attendait Madame de Privat. J’imagine le peintre faisant un bon nombre de propositions, montrant en référence des toiles qu’il avait déjà réalisées ou proposant à sa commanditaire quelques idées modernes des peintres de Paris dont il devait avoir eu connaissance. De tous ces prémices on ne sait rien. Mais le tableau est là, et par sa composition, son style, son sujet, il nous en dit beaucoup sur ce qui a pu se jouer et se demander en amont. Il nous renseigne aussi sur le caractère de madame de Privat et sur l’image qu’elle voulait donner d’elle-même.
Tout d’abord Madame a choisi d’être sans son mari mais accompagnée de ses deux enfants et d’un petit chien. Elle reste le personnage principal, c’est son portrait, mais elle a voulu s’entourer de ses deux petites filles. Elle voulait être représentée et figée dans le temps comme ceci : une mère. C’est donc le statut qu’elle choisit de mettre en avant, avant celui d'aristocrate, d’épouse ou de femme pieuse. Ce rôle de mère semble lui plaire et lui apporter de la joie. Son expression nous indique qu’elle vit la maternité ni comme un fardeau ni comme un devoir social ou religieux. Elle est pimpante, souriante et elle trône fièrement avec ses deux filles. Aujourd’hui l’image peut nous paraître naturelle et standardisée. Mais au XVIIIème les codes de la maternité n’étaient pas du tout ceux d’aujourd’hui. Je me plais à imaginer les commentaires des amies de Madame de Privat devant ce tableau : « Tes cheveux sont splendides », « le peintre a très bien rendu ton manteau de robe », « qu’elle bonne idée d’avoir posé avec ce petit chien de race »... Mais est-ce que comme aujourd’hui, où la moindre image amène des débats, certains commentaires auraient amené plus de réflexion ? « Tu fais porter à ton bébé une brassière souple… Tu n’as pas peur qu’il ne pousse pas droit ? » ou au contraire « Pourquoi contraindre le corps de ton bébé? tu ne suis pas les préceptes modernistes ? », « C’est moi où on voit ton sein droit qui dépasse de ta robe ? Tu lui donnes toi-même le sein ? », « Pourquoi avoir mis tes enfants sur le portrait ? Tu passes beaucoup de temps avec eux ? »
Car oui Madame de Privat, sait qu’un portrait n’est pas qu’une simple image représentant les caractéristiques physiques et qu’il peut aussi permettre d’expliquer aux autres qui l’on est et qui l’ont veut être. Alors elle ne s’en prive pas.
Elle dit qui elle est et ce qu’elle décide. D’abord elle montre qu’elle suit la mode et qu’elle est coquette comme en témoigne cette impressionnante chevelure fleurie, artistiquement voilée, poudrée, architecturée. Elle semble à la limite du too much… Mais bon, on se fait pas tirer le portrait tous les quatre matins alors autant charger un peu la coiffure et puis en copiant ce qui se fait de plus sophistiqué ne montre-ton pas aussi son statut social ? De toute façon sa robe à la polonaise, sa grosse coiffure, elle n’a pas que ça d’important dans sa vie maintenant. Elle a deux petites filles et elle veut s’impliquer dans leurs soins et leurs éducations, et elle le montre ici. Elle veut tisser du lien avec ses enfants qui selon elle ne sont pas que des adultes en devenir mais bien des petites personnes avec leur individualité et leur sensibilité. En cela elle est moderne.
C’est une mère moderne qui se soucie des nouveaux préceptes sur l’éducation et qui aspire à davantage de rapprochement envers ses filles qu’elle a dû recevoir enfant de sa propre mère. Nourris par des nourrices, et élevés à distance des parents, les enfants riches du XVIIIème ne recevaient que très peu le lien maternel. De plus la mortalité enfantine étant très forte on attendait, et ce dans tous les milieux sociaux, que ces fragiles individus deviennent plus grands pour s’attacher à eux et leur accorder de l’importance. Enfin leurs petits corps fragiles étaient vus comme « à transformer ». Pour qu’un enfant marche et se tienne droit il fallait le « façonner ». On plaçait son corps dans des vêtements rigides et on pinçait son petit nez pour qu’il prenne sa forme correcte. La nature ne faisait pas bien les choses. Il fallait agir sur elle pour devenir un être humain. Et puis des idées nouvelles sont arrivés. Elles amenèrent un nouvel humanisme, plus sentimental et réconciliant l’homme et la nature. Le livre de Jean-Jacques Rousseau Emile ou de l’Education, publié en 1762 s’était largement diffusé et ses idées modernes sur l’enfant commençaient à porter du fruit aux quatre coins du pays.
Ce nouveau regard sur l’enfant, Madame Privat nous le montre dans son portrait. Ainsi elle souhaite que ses enfants soient représentés dans cette peinture. Elle désire aussi mettre en avant son implication en tant que mère. Le petit bout de sein rose que j’ai abordé de manière anecdotique tout à l’heure veut en fait dire beaucoup. Il nous informe que Madame de Privat allaite sa petite fille et qu’elle en est fière. Le bébé repu qu’elle tient dans les bras, elle semble venir de le nourrir. Sa poitrine généreuse, qui parait à peine contenue par son manteau de robe, elle nous l’offre fièrement au regard comme un attribut féminin et maternel. Peut-être même que les gestes de sa fille aînée, en train de nourrir le petit être qu’elle tient dans ses bras, sont là pour nous rappeler l’acte nourricier de la mère. Peut-être que comme moi, à ce stade de votre lecture, vous serez pris d’une sympathie ou d’une affection pour cette femme. Personnellement elle me touche car elle essaie de se rallier aux préceptes modernes pour être une bonne mère mais elle garde paradoxalement des pratiques anciennes, et déjà contestés à l’époque, comme l’emmaillotement.
Elle semble se créer un rôle de mère qui lui convient piochant de ci de là des idées quitte à ce qu’elles se contredisent. Elle montre aussi qu’elle peut être ultra sophistiquée, féminine et allaiter. J’aime aussi cette peinture parce que derrière le trait un peu naïf du peintre et la pose figée des modèles il se dégage beaucoup de tendresse et de sensibilité. Alors voilà avant de parler d’autres aspects de la féminité, dont certains sont plus graves ou plus douloureux, je voulais introduire ma participation sur ce blog par un portrait joyeux d’une dame toute rose et heureuse avec ses bébés. J’aurais plein de choses à vous dire encore sur l’allaitement, la maternité et la tétée traités par les artistes. Si vous êtes intéressés je continuerais bien volontiers et on pourra s’aventurer du côté de la Renaissance Italienne, de Picasso ou de Yoko Ono.
Je précise que mon interprétation est toute personnelle. Les peintures sont muettes, surtout les méconnues, mais j’aime à les rendre parlantes et à laisser courir mon imagination sur certains détails. J’aurais pu vous donner pour ce tableau que des faits et des chiffres mais j’avais envie de me permettre quelques suppositions et aussi de rattacher l’oeuvre à des questionnements plus actuels.
Psst : Envie d'aller plus loin ?
Si vous êtes passionnés par les costumes anciens (et je pense que beaucoup de lecteurs le sont), et que les costumes locaux vous intéressent, je vous conseille "Histoire du Costume d'Arles" par Odile et Magali PASCAL.
Pour un regard plus scientifique : le catalogue d'exposition Des habits et nous : Vêtir nos identités.
Sur les bébés aux siècles précédents je vous conseille "Naître, et après ? Du bébé à l'enfant" de Drina Candilis-Huisman. Ce livre est accessible, il se lit vite et il est de plus extrêmement bien illustré.
Crédits :
Auteur : Antoinette Novel
Peinture : Antoine RASPAIL, Madame de PrIvat et ses deux filles, 1791. Œuvre conservée au Museon Arlaten, Arles
Photo : Jean-Luc MABY
Merci à la ville d'Arles pour sa participation à la fourniture de la photographie HD de l'oeuvre.
Vous aimez nos articles ? partagez les sur les réseaux sociaux pour nous encourager !
Crédits :
Auteur : Antoinette Novel
Peinture : Antoine RASPAIL, Madame de PrIvat et ses deux filles, 1791. Œuvre conservée au Museon Arlaten, Arles
Photo : Jean-Luc MABY
Merci à la ville d'Arles pour sa participation à la fourniture de la photographie HD de l'oeuvre.
Vous aimez nos articles ? partagez les sur les réseaux sociaux pour nous encourager !
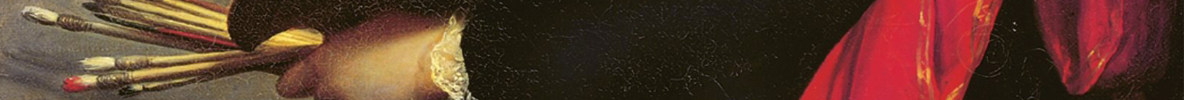


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire